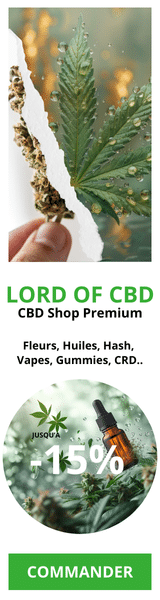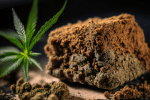Un duo politique inhabituel, composé de Ludovic Mendes (EPR, ex-Renaissance) et d’Antoine Léaument (La France insoumise), vient de livrer un rapport qui va à contre-courant de la ligne répressive défendue par certains responsables politiques français, à commencer par Bruno Retailleau. Pendant 17 mois, ces deux députés ont auditionné des experts, rencontré des acteurs de terrain et collecté des données pour aboutir à une soixantaine de propositions, dont une préconisation phare : légaliser le cannabis « à la française » et dépénaliser plus largement l’usage des drogues, dans un souci de santé publique. Les conclusions de leur travail, rendues publiques ce lundi 17 février, risquent de nourrir un débat intense sur l’avenir de la politique des stupéfiants en France.
Les deux élus l’affirment : la répression systématique des consommateurs n’a pas apporté les effets escomptés en matière de santé publique ni de sécurité. « Cela fait 30 ans que l’on explique que le consommateur de drogue est un délinquant, complice du trafiquant, qu’il a du sang sur les mains. Ça n’a jamais rien changé », constate Ludovic Mendes. De son côté, Antoine Léaument, partisan d’un changement profond de paradigme, revendique une approche tournée vers la prévention, l’accompagnement des usagers et la lutte contre les véritables réseaux criminels.
Cette nouvelle posture s’oppose frontalement à la vision de Bruno Retailleau, sénateur et chef de file d’une droite dure qui réclame un durcissement des sanctions pénales pour les consommateurs. Là où Retailleau voit dans l’usager un délinquant complice, les deux rapporteurs plaident pour une vision de santé publique, inspirée de l’exemple portugais ou de certains modèles nord-américains. Tour d’horizon des points clés de ce rapport ambitieux, de ses répercussions potentielles sur le cadre légal en France et des débats qu’il va forcément susciter.
Un rapport événement : 17 mois de travail et 60 propositions
Le projet a nécessité 17 mois de recherches et d’auditions. Le but : comprendre l’ampleur du trafic de stupéfiants en France, ses racines, ses conséquences, et proposer des solutions concrètes pour endiguer la violence et réduire les risques sanitaires liés à la consommation de drogues. Ludovic Mendes et Antoine Léaument ont exploré plusieurs pistes, consulté différents spécialistes de la santé, magistrats, forces de l’ordre, associations d’usagers, représentants du monde agricole et même des acteurs étrangers engagés dans des démarches de légalisation.
Au terme de leurs travaux, ils s’accordent sur un constat majeur : la politique actuelle, qui criminalise largement l’usage et s’attaque frontalement aux consommateurs, n’a pas rempli ses objectifs. Les chiffres de la consommation de cannabis, de cocaïne ou de MDMA (ecstasy) restent parmi les plus élevés d’Europe. Le marché noir est florissant, et les revenus colossaux du trafic alimentent des réseaux criminels polyvalents, actifs également dans la traite d’êtres humains, le proxénétisme ou la contrebande d’armes.
Sur les 60 propositions du rapport, plusieurs convergent vers une idée phare : réguler le cannabis plutôt que de le réprimer, en créant un véritable marché légal et encadré, piloté par une instance spécialisée. En parallèle, les rapporteurs suggèrent une forme de dépénalisation pour la possession de petites quantités d’autres drogues (notamment la cocaïne), dans l’optique de privilégier l’accompagnement sanitaire plutôt que les poursuites pénales systématiques.
Légalisation « à la française » : le cœur de la proposition
Les deux députés avancent l’idée d’une légalisation « à la française » du cannabis, c’est-à-dire un modèle adapté aux spécificités administratives, juridiques et culturelles de l’Hexagone. L’option proposée s’éloigne à la fois du système de coffee-shops tolérés aux Pays-Bas et de la logique de marché très libérale pratiquée dans certains États américains. Au contraire, l’idée serait de mettre en place un cadre rigoureux, semblable à la régulation des jeux d’argent.
Une instance dédiée pour attribuer des licences
Le rapport insiste sur la création d’une autorité analogue à l’Agence nationale des jeux (ANJ), qui encadre actuellement les paris sportifs et autres pratiques de jeu. Cette structure indépendante serait chargée d’émettre des licences auprès de différents acteurs :
-
Agriculteurs : Des licences de culture seraient attribuées à des exploitants souhaitant se lancer dans la production de cannabis. Ces agriculteurs devraient se conformer à des normes précises, aussi bien en matière de respect de l’environnement que de contrôle du taux de THC.
-
Revendeurs : Les points de vente – boutiques spécialisées ou pharmacies – seraient contraints de respecter des conditions strictes (horaires de vente, interdiction de publicité ciblant les mineurs, vérification de l’âge des clients, etc.).
-
Clubs cannabiques : Inspirés des « Cannabis Social Clubs » espagnols, ces entités seraient autorisées à faire pousser et à distribuer du cannabis à leurs membres, dans un cadre associatif et non lucratif.
-
Culture à domicile : Le rapport propose de permettre aux particuliers de cultiver chez eux un nombre limité de plants, sous réserve d’une déclaration et d’un encadrement strict (nombre de plants, impossibilité de revente, etc.).
Selon Ludovic Mendes et Antoine Léaument, cette instance publique ou parapublique aurait un rôle clé : fixer des normes de production, veiller à la qualité sanitaire des produits, éviter la surproduction et garantir que les revenus générés soient taxés et réinjectés dans la prévention et les structures de santé.
Des objectifs multiples : santé, sécurité et économie
Cette légalisation vise plusieurs finalités :
-
Assainir le marché : Retirer le commerce du cannabis des mains des trafiquants et le confier à des filières légales contrôlées, pour mieux lutter contre les mafias, la violence dans certains quartiers et le blanchiment d’argent.
-
Protéger la santé publique : Mettre en place des contrôles de qualité, informer le consommateur sur les taux de THC et de CBD, éviter que des produits frelatés ne circulent, et financer massivement la prévention et le soin des addictions.
-
Développer un secteur économique : Créer des emplois, offrir aux agriculteurs français la possibilité de se diversifier, et dégager de nouvelles recettes fiscales. Les rapporteurs évoquent la manne de plusieurs milliards d’euros annuels qu’une fiscalisation de ce marché pourrait générer.
-
Avoir une logique de réduction des risques : Distinguer l’utilisateur récréatif occasionnel de la personne en situation d’addiction, pour proposer un suivi sanitaire pertinent, sans saturer les tribunaux pour de simples usages personnels.
Un changement de paradigme face à la ligne de Bruno Retailleau
La proposition de dépénalisation et de légalisation tranche nettement avec l’approche soutenue depuis plusieurs mois par Bruno Retailleau, qui martèle la nécessité d’une fermeté accrue à l’égard des consommateurs. Pour le sénateur, frapper plus fort sur la demande dissuaderait l’usage et, par ricochet, assécherait le trafic. Ludovic Mendes réfute cette logique : « Cela fait 30 ans que l’on explique que le consommateur de drogue est un délinquant, complice du trafiquant, qu’il a du sang sur les mains. Ça n’a jamais rien changé. »
Les deux députés insistent sur les statistiques de consommation en France : une hausse constante depuis plusieurs décennies, malgré la prohibition et la répression. S’ils ne nient pas le rôle du droit et de la police, ils suggèrent de recentrer la répression sur les véritables trafiquants, et non sur des usagers qui auraient besoin d’aide ou qui consomment de manière occasionnelle.
Cet écart entre la vision dite répressive et la vision plus « sanitaire » reflète un clivage de fond dans la classe politique française : d’un côté, ceux qui misent sur la dissuasion par la peur du gendarme ; de l’autre, ceux qui estiment que cette méthode a montré ses limites, et qu’il faut envisager une approche plus pragmatique.
Des propositions divergentes sur la cocaïne et les autres drogues
Si les deux députés s’accordent sur la légalisation encadrée du cannabis, ils ne sont pas parfaitement alignés au sujet d’autres drogues plus dures, comme la cocaïne ou la MDMA.
-
La position de Ludovic Mendes : Il suggère une dépénalisation de la détention de moins de 3 g de cocaïne, assortie d’une amende forfaitaire entre 3 et 6 g. Au-delà de 6 g, l’infraction relèverait toujours du juge pénal. L’idée est de « prioriser » la lutte contre les trafiquants, tout en prenant en compte le fait qu’une partie des consommateurs sont dépendants et peuvent se retrouver dans des situations délicates.
-
La position d’Antoine Léaument : Le député insoumis se montre plus radical dans la dépénalisation. Il s’oppose notamment au principe d’une amende forfaitaire au-dessus de 3 g, estimant que la logique pénale demeure contre-productive pour les usagers, même si la quantité dépasse cette limite.
Pour justifier sa position, Ludovic Mendes fait référence au Portugal, où la dépénalisation des usages de drogues a permis de meilleurs résultats sur le plan de la santé publique : « Le Portugal a connu de gros problèmes de consommation d’héroïne. La dépénalisation des usages a permis de bien meilleurs résultats en termes de santé publique, du fait d’une meilleure prise en charge, et parce que les personnes avaient moins peur de se faire accompagner. »
Il n’est donc pas question de légaliser, au sens strict, toutes les drogues en France, mais plutôt de revoir les sanctions encourues pour les petits usagers d’opiacés, de cocaïne ou de MDMA, dans un esprit de réduction des risques et d’orientation vers des dispositifs de soin.
Un volet anticorruption et un statut de lanceur d’alerte renforcé
Le rapport aborde aussi de front la question du blanchiment et de la corruption, considérées comme des rouages essentiels du narcotrafic. Les conclusions évoquent des situations où des dockers, douaniers ou avocats se laissent corrompre par l’appât d’un gros chèque pour faciliter l’importation ou la circulation de drogue.
Ludovic Mendes insiste sur l’importance d’étendre la définition de la corruption, jusqu’ici souvent cantonnée aux seuls agents publics : « On sait que des avocats ont pu être impliqués. Sauf que l’on ne retient jamais la corruption pour ces personnes qui ne relèvent pas tous du gouvernement ou de l’État. Je demande que la corruption soit reconnue pour le privé. »
Le rapport recommande également de créer ou renforcer un statut de lanceur d’alerte pour ceux qui dénoncent des faits de blanchiment ou de corruption, et qui se retrouvent parfois menacés par les réseaux criminels.
Santé publique et protection de la jeunesse
Si la légalisation du cannabis occupe le devant de la scène, les deux députés insistent régulièrement sur la nécessité de protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs. Un point crucial consiste à interdire strictement la vente aux moins de 18 ans (voire 21 ans, selon certains scénarios) et à mettre en place des dispositifs de sensibilisation précoce.
Loin d’une banalisation de la consommation, la légalisation encadrée s’accompagnerait de mesures de prévention, de campagnes d’information et d’un accompagnement médico-psychologique plus accessible pour les adolescents présentant des signes de dépendance. Dans ce schéma, les boutiques autorisées ou les « clubs cannabiques » auraient l’obligation de vérifier l’âge des clients, sous peine de sanctions sévères, à l’image de la réglementation déjà en vigueur pour l’alcool ou le tabac.
Il est également prévu de renforcer les moyens de la médecine scolaire et des centres de soins spécialisés en addictologie, afin que les jeunes consommateurs puissent bénéficier d’un suivi adapté, sans crainte d’être poursuivis pénalement.
La piste d’un référendum et la question de la volonté politique
Les rapporteurs évoquent une proposition pour le moins ambitieuse dans le paysage institutionnel français : organiser un référendum sur la légalisation du cannabis. Cette idée répond à un double constat : d’une part, la question dépasse la sphère strictement parlementaire en touchant aux valeurs sociétales et aux modes de vie ; d’autre part, Emmanuel Macron a récemment fait connaître son intérêt pour des formes de consultation plus directes.
Rien ne dit que le président de la République souhaite s’aventurer sur un terrain aussi sensible. Mais la proposition est lancée : d’un point de vue politique, un référendum pourrait acter la volonté populaire et donner une légitimité forte à la réforme. Restent les nombreuses inconnues : la formulation de la question, le risque d’un débat hyper-polarisé, la probabilité que l’exécutif reprenne à son compte une telle initiative.
Dans l’hypothèse où un référendum serait tenu, les partisans d’une réforme affûtent déjà leurs arguments, en s’appuyant sur les résultats de pays ayant légalisé ou dépénalisé, tandis que les opposants avancent les risques de banalisation et d’augmentation de la consommation.
Les répercussions sur le marché noir et la sécurité
L’objectif avoué de ce nouveau dispositif serait de priver les réseaux de revente d’une grande partie de leurs revenus. Le marché du cannabis illégal en France se chiffre à plusieurs milliards d’euros par an. Selon les partisans de la légalisation, la mise en place d’un circuit officiel, avec un contrôle de qualité et un accès réglementé, réduirait significativement les profits des organisations criminelles et limiterait la guerre des territoires qui frappe certains quartiers.
Toutefois, l’expérience canadienne ou celle de certains États américains montre qu’un marché noir peut perdurer même après la légalisation, surtout si le cannabis légal se retrouve trop taxé et donc plus cher à l’achat. Pour éviter cet écueil, les auteurs du rapport recommandent d’équilibrer la fiscalité : assez élevée pour financer la prévention et la santé, mais pas au point de maintenir une forte compétitivité du marché clandestin.
Sur le plan sécuritaire, les forces de l’ordre pourraient redéployer une partie de leurs effectifs vers des missions plus ciblées : traque des trafiquants de drogues dures, lutte contre la criminalité organisée, contrôle des points de vente agréés. Une telle réorientation impliquerait un effort de formation et une évolution des priorités policières, parfois délicates à mettre en place.
Le cannabis en France : un marché déjà existant
Même si le cannabis est officiellement interdit (au-delà de 0,3 % de THC), la réalité sur le terrain est celle d’une consommation massive, toutes classes sociales confondues. Selon des études récentes, la France demeure un des pays européens où la consommation de cannabis est la plus élevée, en particulier chez les jeunes.
Dans le même temps, le succès du CBD (cannabidiol), autorisé sous certaines conditions, a familiarisé une partie de la population avec les dérivés du chanvre. Les boutiques spécialisées en CBD se sont multipliées sur le territoire, attirant un public en quête de relaxation, de bien-être ou de gestion du stress. Cette prolifération des produits au CBD a contribué, selon certains observateurs, à banaliser l’idée qu’on puisse consommer du cannabis sous diverses formes, sans nécessairement chercher l’effet psychotrope lié au THC.
Dans ce contexte, les partisans de la légalisation estiment que le passage à un marché réglementé pour le THC ne serait qu’une étape supplémentaire, déjà amorcée par la légalisation partielle du CBD et la tolérance sociétale grandissante envers le cannabis.
Le potentiel économique d’une légalisation encadrée
Les estimations varient, mais beaucoup d’experts s’accordent à dire que la légalisation du cannabis pourrait générer plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. Entre la taxation des ventes, la création d’emplois (agriculteurs, distributeurs, laboratoires de contrôle, etc.) et l’émergence de services annexes (tourisme, événements autour du chanvre, formations professionnelles), la manne financière est potentiellement substantielle.
Le rapport Mendes-Léaument propose de réinvestir massivement ces ressources dans :
-
La prévention et les soins : structures de santé, programmes de réduction des risques, information dans les collèges et lycées, formations pour les professionnels de santé et travailleurs sociaux.
-
La recherche : financement d’études sur l’usage thérapeutique du cannabis, l’analyse des addictions, le développement de souches moins nocives, etc.
-
Le contrôle et la répression ciblée : renforcement des moyens judiciaires et policiers pour lutter contre les réseaux criminels restant actifs en marge du marché légal (trafic international, drogues dures, etc.).
Cette perspective d’une filière française du cannabis, labellisée et contrôlée, séduit aussi certains agriculteurs, qui y voient une opportunité de diversification de leurs revenus, dans un secteur en mutation (baisse de la rentabilité de la viande, du lait, etc.). Un label de qualité « cannabis français », inspiré de l’esprit des appellations d’origine contrôlée, est parfois évoqué.
L’exemple du Portugal et d’autres modèles internationaux
Le rapport s’appuie sur des références étrangères pour étayer ses propositions. Le Portugal, souvent cité, a opté pour une dépénalisation de l’usage de toutes les drogues depuis 2001, préférant un suivi sanitaire et social plutôt que la sanction pénale. Les autorités portugaises observent des résultats relativement positifs en termes de santé publique : baisse des overdoses, meilleure orientation des personnes dépendantes vers des structures d’aide, diminution de la stigmatisation des usagers.
En ce qui concerne la légalisation du cannabis, les regards se tournent vers :
-
Le Canada : Depuis 2018, le cannabis y est légal pour un usage récréatif. L’État fédéral fixe un cadre global, tandis que chaque province définit ses règles de distribution. Les retours sont mitigés : le marché noir n’a pas totalement disparu, mais la légalisation a permis une meilleure supervision sanitaire et d’importants revenus fiscaux.
-
Les États-Unis : Le cannabis demeure illégal au niveau fédéral, mais de nombreux États (Californie, Colorado, Washington…) l’ont légalisé pour un usage récréatif. Ces laboratoires locaux permettent de constater qu’une fiscalité trop élevée peut maintenir l’attrait du marché illicite, mais qu’un encadrement correct et des campagnes de prévention peuvent limiter les dérives.
-
L’Espagne : Les « clubs sociaux » de cannabis, tolérés dans certaines provinces, autorisent la culture et la consommation collective dans un cadre associatif. Ce modèle inspire partiellement les deux députés français pour la création de « clubs cannabiques » sous licence.
-
Les Pays-Bas : Contrairement aux idées reçues, la production de cannabis y est toujours officiellement illégale. Seule la revente dans les coffee-shops bénéficie d’une tolérance. Ce système paradoxal a parfois montré ses limites (approvisionnement occulte, influence de la criminalité organisée), bien qu’il ait eu le mérite de décriminaliser le consommateur.
Ces différents exemples ne sont pas tous transposables tels quels en France, mais ils offrent un éventail de solutions pour imaginer un modèle national.
Enjeux politiques et clivages partisans
Le fait qu’un député issu de la majorité présidentielle (même s’il est désormais dans le groupe EPR) et un député LFI s’allient pour proposer une légalisation du cannabis constitue un signal politique fort. Cela démontre qu’il existe, sur ce sujet, des majorités d’idées qui peuvent traverser les clivages traditionnels gauche-droite.
Néanmoins, l’initiative ne fait pas l’unanimité. Dans la majorité, certains élus restent hostiles à l’idée, redoutant une envolée de la consommation ou une désapprobation d’une partie de l’électorat conservateur. À droite, la ligne portée par Bruno Retailleau semble trouver de l’écho chez d’autres figures publiques qui défendent une répression accrue. Quant au Rassemblement national, il se montre plutôt partagé : certains cadres y expriment un refus catégorique de toute légalisation, d’autres s’ouvrent à l’idée d’une dépénalisation limitée.
À gauche, la situation est également complexe. Si les écologistes, le Parti socialiste ou LFI sont traditionnellement plus ouverts à la dépénalisation, certains responsables politiques de ces formations craignent que la légalisation totale envoie un « mauvais signal » ou renforce les inégalités de santé (par exemple, dans les quartiers populaires déjà touchés par d’autres problèmes sociaux).
Cette diversité de sensibilités laisse entrevoir des débats animés au Parlement, si jamais une proposition de loi se fonde sur le rapport Mendes-Léaument.
Un « réarmement des moyens judiciaires »
Parmi les propositions, on trouve l’idée d’un « réarmement des moyens judiciaires ». Les deux députés ne préconisent pas un laxisme généralisé. Au contraire, ils souhaitent doter la justice de davantage de ressources pour :
-
Poursuivre efficacement les trafiquants : En ciblant les réseaux internationaux, les importateurs de grosses quantités, les organisations criminelles structurées qui tirent profit de la prohibition.
-
Lutter contre la corruption : Élaborer un arsenal législatif permettant de sanctionner toute personne impliquée dans des faits de corruption, qu’elle soit agent public ou professionnel du secteur privé.
-
Accompagner les usagers : Mettre en place des juridictions spécialisées pour traiter rapidement les dossiers liés aux conduites addictives, avec un volet sanitaire et social plus large.
Les rapporteurs estiment que la décriminalisation du simple usage permettrait de décharger les tribunaux d’une multitude d’affaires liées à la détention de petites quantités de drogue, afin de se concentrer sur les délits et crimes vraiment graves.
Protection des mineurs et responsabilisation des adultes
La question de la protection des jeunes est récurrente dans le débat. Légaliser le cannabis suscite la crainte d’une banalisation auprès des collégiens et lycéens, plus vulnérables aux effets toxiques. Les tenants d’une légalisation encadrée répondent qu’actuellement, le marché noir ne vérifie pas l’âge des acheteurs et qu’une situation de prohibition totale n’empêche pas des mineurs de se procurer du cannabis.
Dans le dispositif imaginé, les sanctions contre la vente ou la fourniture de produits stupéfiants à des mineurs seraient renforcées, tandis que le contrôle à l’entrée des points de vente légaux serait obligatoire, sous peine de retrait de licence. Les deux députés insistent sur le volet préventif : formation des enseignants et éducateurs, campagnes d’information adaptées, mobilisation des parents.
Pour les adultes, l’idée est d’assumer une démarche de responsabilisation. En achetant du cannabis légal, chacun saurait précisément ce qu’il consomme (taux de THC, absence de substances nocives) et s’engagerait à respecter la loi, notamment sur les lieux de consommation. Des interdictions, calquées sur celles relatives au tabac ou à l’alcool (pas de consommation au volant, pas de consommation sur le lieu de travail, etc.), pourraient être instaurées.
Quel avenir pour le débat ?
La publication de ce rapport est un événement médiatique et politique. Reste à savoir s’il aura un impact concret sur le droit français. Les options sont multiples :
-
Débat parlementaire : Les deux élus peuvent déposer une proposition de loi, qui sera débattue en commission, amendée, puis soumise au vote de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les réticences de certaines forces politiques sont toutefois importantes.
-
Initiative gouvernementale : L’exécutif pourrait s’emparer d’une partie des propositions, surtout si Emmanuel Macron envisage d’ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis ou sur la dépénalisation de certains usages. Cela dépendra de l’orientation politique et de la pression de l’opinion publique.
-
Référendum : Comme évoqué dans le rapport, l’idée d’une consultation directe des Français plane, même si elle demeure incertaine dans le cadre institutionnel actuel. C’est probablement l’option la plus audacieuse et la plus difficile à mettre en œuvre.
-
Statu quo : Il est tout à fait possible que ce rapport suscite un intérêt éphémère, avant que d’autres priorités ne reprennent le dessus. La complexité du sujet, la multiplicité des parties prenantes et les divergences politiques pourraient bloquer toute réforme à court terme.
Les mois à venir seront donc décisifs pour évaluer si l’appel conjoint d’un député issu de l’arc présidentiel et d’un député de La France insoumise réussit à faire bouger les lignes au plus haut niveau. L’existence d’une demande sociétale pour une approche moins répressive est palpable, comme l’indique la popularité croissante du CBD ou la curiosité pour les expériences de légalisation à l’étranger.
Dans le même temps, les oppositions, portées par des responsables politiques comme Bruno Retailleau, continueront de défendre une stratégie punitive, appuyée par une partie de l’opinion publique qui redoute la banalisation des drogues. Les inquiétudes relatives à l’augmentation de la consommation chez les jeunes, l’impact sur la sécurité routière ou la santé mentale demeurent des arguments puissants pour maintenir la prohibition.
Le rapport Mendes-Léaument, avec ses 60 propositions, s’impose en tout cas comme la plus ambitieuse tentative d’ouvrir le champ législatif français à une réglementation plus souple et mieux encadrée des drogues. Les auteurs espèrent, par ce travail transpartisan, initier une révolution des mentalités, soutenus par l’évolution observée chez plusieurs de nos voisins européens et par un contexte international de plus en plus favorable à la légalisation du cannabis.
Les enjeux, qu’ils soient sanitaires, économiques ou sécuritaires, sont immenses. L’idée d’une légalisation « à la française » du cannabis, conjuguée à la dépénalisation partielle d’autres drogues, ne fait plus seulement l’objet de débats théoriques : elle prend forme dans un rapport parlementaire solide, fruit d’un an et demi de recherches. Les réactions qui vont suivre, au sein du gouvernement, des partis politiques, de l’opinion et des médias, diront si la France est prête à franchir ce cap historique et à rompre avec des décennies de prohibition qui, selon Ludovic Mendes et Antoine Léaument, n’ont pas rempli leurs promesses.
En attendant, le simple fait que deux parlementaires d’horizons aussi différents appellent de concert à cette évolution marque un tournant : jamais la question de la légalisation, de la dépénalisation et de la réorientation de la politique des stupéfiants n’avait été portée de manière aussi conjointe, avec un tel niveau d’accord sur l’essentiel. Bien au-delà d’une alliance ponctuelle, ce rapprochement pourrait ouvrir la voie à un front commun d’élus qui, par-delà leurs divergences, s’entendraient sur l’urgence de mettre fin à l’inefficacité des politiques actuelles et d’explorer enfin une piste sanitaire et sociale pour répondre à l’un des défis majeurs de notre société.